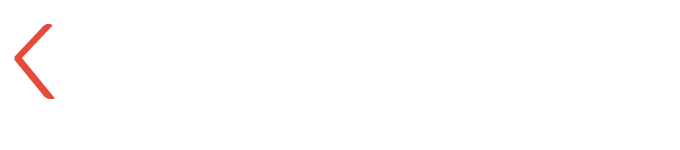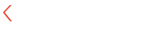Cartel du recrutement : Les autorités de concurrence disent non aux promesses de ne pas piquer les salariés du voisin

Deux sanctions en deux mois pour des accords de non-débauchage ; l’entente est lourdement sanctionnée
L’été 2025 a été l’occasion pour la Commission européenne et l’Autorité (française) de la concurrence de faire passer un message clair aux acteurs économiques : les accords de non-débauchage constituent des ententes anticoncurrentielles par objet.
Le 2 juin 2025, la Commission européenne[1] a ouvert les hostilités en infligeant une amende record de 329 millions d’euros à Delivery Hero et Glovo pour avoir mis en place, entre 2018 et 2022, une entente anticoncurrentielle multidimensionnelle dans le secteur des services en ligne de livraison de repas :
- échange d’informations sensibles,
- répartition géographique des marchés,
- et, pour la première fois, la sanction d’un accord de non-débauchage des salariés (ou no-poach agreement).
En clair, les deux entreprises s’étaient entendues pour ne pas débaucher leurs salariés respectifs. Cet accord avait d’abord été inséré dans un pacte d’actionnaires lors de l’acquisition d’une participation minoritaire par Delivery Hero en 2018, avant d’être élargi à un accord général de non-recrutement.
Les amendes se répartissent ainsi : 223 millions pour Delivery Hero et 106 millions pour Glovo, réduites de 10 % grâce à un accord de règlement et à la reconnaissance de responsabilité.
L’Autorité de la concurrence Française a emboité le pas le 11 juin 2025 en sanctionnant des accords similaires dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques, avec une amende d’un montant total de 29,5 millions d’euros[2].
Quelle distinction entre clause de non-débauchage et de non-sollicitation ?
Les clauses de non-sollicitation examinées par l’Autorité de la concurrence ont été considérées comme n’ayant pas d’objet ou d’effet anticoncurrentiel, alors qu’elles interdisaient le recrutement du personnel de l’autre partie « même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur »[3].
En effet, les clauses étaient limitées à des catégories de collaborateurs précises, en lien avec l’exécution d’un projet spécifique, pendant une durée limitée, et prévoyaient une clause pénale en cas de violation de l’interdiction qui ne compensait que partiellement le préjudice subi (pas de caractère dissuasif significatif).
A l’inverse, la clause de non-débauchage prévue dans le cadre d’un gentleman’s agreement avait bien un objet et un effet anticoncurrentiel. Contrairement aux clauses de non-sollicitation, l‘accord de non-débauchage était général et prévoyait peu ou pas de limites :
- il portait non seulement sur les salariés, mais aussi les fournisseurs, sous-traitants et intérimaires ;
- aucune limite de durée ;
- aucune limitation de périmètre de contrats ou de projets.
Les clauses de non-sollicitation sont donc considérées comme licites, car limitées et proportionnées, tandis que les accords de non-débauchages très généraux visant à « limiter au strict incontournable » les mouvements de personnel ont été considérés comme des ententes anticoncurrentielles par l’objet.
Ces clauses étant couramment insérées dans les partenariats, il peut être opportun de vérifier dans vos contrats que celles que vous utilisez ne portent pas atteinte à la liberté du travail, reconnue tant par le droit français que par le droit européen[4].
USA vs Europe : comment les accords « no-poach » sont-ils traités ?
Aux États-Unis, les accords de non-débauchage sont appréhendés de la même manière par le droit de la concurrence depuis longtemps.
On relèvera ainsi qu’en 2011, Apple, Adobe, Google, Intel et d’autres participants à ces accords de non-débauchage ont fait l’objet de poursuites de la part du Department of Justice (DOJ) et ont été contraint d’accepter une transaction visant à cesser les pratiques.
A la suite de cette transaction avec le DOJ, les parties à l’entente ont fait l’objet d’une class action de la part des salariés lésés avec à la clé une indemnisation de 435 millions de dollars[5].
Sécurisez vos contrats, protégez votre compétitivité
Ces deux affaires rappellent en premier lieu que le marché du travail est un marché de services qui n’est pas hors du champ du droit de la concurrence. Le droit de la concurrence s’intéresse aussi à vos ressources humaines et à vos accords de gouvernance. Le Cabinet KEROSE intervient spécifiquement pour :
- Analyser vos contrats commerciaux et pactes d’actionnaires : audit, identification et révision des clauses de non-sollicitation, de non-concurrence ou d’exclusivité qui pourraient entraîner un risque pour l’activité de votre entreprise.
- Sécuriser vos relations de distribution et partenariats : rédaction de contrats conformes aux réglementations européennes et françaises en matière de pratiques concurrentielles.
- Prévenir le risque concurrentiel : conseil opérationnel et formation pour prévenir le risque d’entente illicite.
- Défendre vos intérêts : construction d’une stratégie de défense et de négociation face à un concurrent, un partenaire ou une autorité de régulation. Assistance et représentation devant les juridictions et autorités.
Vous avez un doute sur une clause ou une pratique ? Nos avocats en droit de la concurrence et des affaires vous accompagnent pour sécuriser vos contrats et protéger votre entreprise. Nous sommes à votre écoute.
[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1356
[2] ADLC, 11 juin 2025, n° 25-D-03
[3] Ibid, §571
[4] Pour le droit français, la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’une « stipulation contractuelle qui porte atteinte aux principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » (Cass, Com, 27 mai 2021, n° 18-23.261) ; En droit européen, la liberté du travail est protégée par l’article 45 du TFUE.
[5] https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-603-5827?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
Crédit photo : Andrea Piacquadio