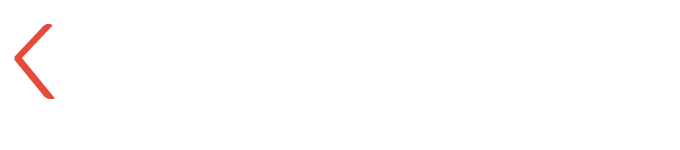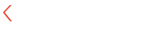Quand la parole commerciale dérape : liberté d’expression et dénigrement sous contrôle

La Cour de cassation, dans l’affaire dite de la DMLA (Cass. Com., 25 juin 2025, n° 23-13.391), a recadré l’analyse menée par la Cour d’Appel de Paris au sujet d’allégations négatives diffusées par des laboratoires pharmaceutiques sur un produit concurrent.
Au-delà du terrain de l’abus de position dominante, la décision interroge sur la manière d’articuler liberté d’expression et dénigrement.
Faut-il y voir l’ajout d’une 4ème condition – liée à l’intention – dans l’action en concurrence déloyale ?
Quand l’information devient une stratégie commerciale
À l’origine, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné trois laboratoires (Genentech, Novartis, Roche) pour avoir freiné l’usage d’Avastin dans le traitement de la DMLA, notamment en diffusant des communications de nature à en discréditer l’emploi hors Autorisation de Mise sur le Marché par rapport au Lucentis, bien plus onéreux. La Cour d’appel de Paris (16 févr. 2023) avait annulé la décision, estimant que les propos relevaient d’un débat d’intérêt général (santé), reposaient sur une base factuelle suffisante et étaient exprimés avec mesure — trois conditions classiquement admises pour échapper à la qualification de dénigrement.
La Cour de cassation casse presque intégralement cet arrêt. D’une part, elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir pleinement envisagé la concurrence potentielle entre produits sur la période en cause. D’autre part, elle exige une appréciation plus restrictive de la liberté d’expression dans le domaine commercial, où les États disposent d’une large marge d’appréciation pour en limiter l’usage, et d’examiner si un objectif anticoncurrentiel n’animait pas la communication en cause.
Le discours commercial : une parole « sous surveillance »
La décision rappelle que la liberté d’expression (art. 10 CEDH) peut être plus étroitement encadrée lorsqu’elle s’exerce dans la sphère économique. Autrement dit, la référence au débat d’intérêt général ne suffit pas à « blanchir » un message d’entreprise lorsqu’il influence le jeu concurrentiel.
Pour la Haute juridiction, c’est au regard des critères du droit des abus (art. 102 TFUE / L. 420-2 C. com.) – et de la « concurrence par les mérites » – que l’on apprécie le caractère admissible du discours d’une entreprise en position dominante, indépendamment de la liberté d’expression invoquée pour échapper à la qualification de pratique anticoncurrentielle.
Cette position n’exclut pas la liberté d’expression ; néanmoins elle hiérarchise son contrôle en contexte commercial : plus la parole peut potentiellement fausser la concurrence, plus l’examen sera strict.
Derrière les mots, les intentions : la nouvelle clé du dénigrement ?
Second apport majeur : l’arrêt reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les entreprises poursuivaient un but anticoncurrentiel ; par exemple, en alertant sur des risques juridiques pour les prescripteurs sans y être tenues au titre de la pharmacovigilance. L’intention n’est pas érigée en condition autonome de l’abus, mais elle devient une circonstance factuelle pertinente pour qualifier la pratique.
Transposée au terrain de la concurrence déloyale, cette grille de lecture pourrait conduire à compléter la trilogie bien connue qui permet d’exclure le dénigrement (intérêt général, base factuelle suffisante, mesure) par une quatrième exigence : la bonne foi entendue comme volonté de participer à la recherche de la vérité, plutôt que de biaiser le marché (voir l’analyse en ce sens de Mme Hélène Aubry dans l’article « Concurrence – Liberté d’expression, abus de position dominante et dénigrement » dans Contrats Concurrence Consommation n° 11, Novembre 2025, comm. 143).
Autrement dit : une communication négative sur un produit ne devrait échapper à la qualification de dénigrement que si elle (i) touche un sujet d’intérêt général, (ii) repose sur des faits suffisamment établis, (iii) est formulée avec prudence, et (iv) procède d’une volonté de participer à l’apparition ou à la diffusion de la vérité.
De la communication à la précaution : quelques réflexes juridiques
- Ne plus se réfugier derrière le triptyque « intérêt général / faits / mesure »
L’argument classique « nous informons le public » ne protège plus, à lui seul, un discours critique.
Pour les entreprises, il devient essentiel de pouvoir démontrer la bonne foi de la démarche : prouver que la communication visait réellement à informer — et non à freiner un concurrent ou influencer le marché.
À l’inverse, pour celui qui s’estime victime, l’analyse ne doit plus se limiter au contenu des propos : il faut examiner leur contexte de diffusion – le public ciblé, les canaux utilisés, la répétition du message ou son moment de diffusion – afin d’en déduire l’intention stratégique. Une approche indispensable, notamment lorsque l’auteur du discours est un concurrent direct ou s’exprime en dehors de tout cadre réglementaire.
- Repenser la « base factuelle suffisante » en contexte d’incertitude
L’arrêt rappelle que la vérité scientifique n’est jamais figée, et que s’en prévaloir peut devenir risqué.
Lorsque les données sont incertaines ou contestées, la question n’est plus seulement de savoir si l’information est exacte, mais pourquoi et comment elle est utilisée.
La prudence s’impose : financer ou relayer sélectivement certaines études, dramatiser des risques, ou omettre des éléments nuançant un propos peut révéler une intention commerciale déguisée. Autrement dit, la solidité factuelle ne se mesure plus uniquement au contenu, mais à la finalité du message.
- Adapter la stratégie probatoire
Pour les praticiens, la gestion du risque passe désormais par une approche globale de la preuve. Il ne suffit plus de conserver les éléments de contenu (exactitude ou ton des messages) : il faut aussi documenter le contexte et les motivations de la communication. Consignes internes, briefs marketing, échanges avec des partenaires ou relais externes, refus de coopérer à des évaluations neutres ; autant de pièces qui pourront établir ou contester la bonne foi de l’émetteur.
Cette vigilance doit devenir devient un réflexe stratégique, tant pour prévenir le risque de contentieux que pour démontrer, le moment venu, que la communication commerciale a respecté les frontières de la loyauté.
Vous avez un doute sur une pratique ? Nos avocats en droit de la concurrence et des affaires vous accompagnent pour sécuriser vos contrats et protéger votre entreprise.
Nous sommes à votre écoute.